 Vendredi dernier, je vous parlais de Chuck D, et bien aujourd’hui un p’tit post pour un monsieur qui influença énormément le MC de Public Enemy, Gil-Scott Heron.
Vendredi dernier, je vous parlais de Chuck D, et bien aujourd’hui un p’tit post pour un monsieur qui influença énormément le MC de Public Enemy, Gil-Scott Heron.Ce personnage apparaît au bon moment dans le paysage musical noir, à savoir au début des années 70’s: après les assassinats de Malcom X, Martin Luther King et les émeutes à Watts. En effet, hormis quelques exceptions, on peut dire que les blacks US musicalement sont assez propret (j’entend en musique dite populaire, je ne parle ni de jazz ni de blues et ni de Little Richard!), le plus bel exemple est la maison de disque Motown, dans le genre consensuel... Heureusement, la fin des années 60 va réveiller les consciences. Deux genres noires vont naître le funk initié par Sly et le dr funkenstein Georges Clinton et ce qu’on peut appeler le proto-rap, avec comme créateur Gil et the last prophet.
On notera qu’après avoir signé ses disques en solo, Gil les signera avec Brian Jackson, pour une très bonne collaboration, Jackson apportant une richesse musicale que n’avaient pas ses premiers disques. Puis ce fut la séparation (d’après le père Jackson, un problème d’égo, sans compter qu’il n’aurait jamais vu les sous venir...), et une bonne grosse traversée du désert pendant les années 80 (tiens comme c’est original), puis finalement un retour dans les années 90 (re-tiens comme c’est original…).
Par contre, aujourd’hui, je ne sais pas s’il est sorti de prison, quelques problèmes de shit…


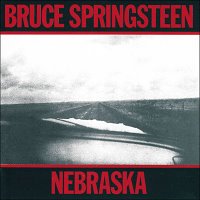









.jpg)
