L'annonce ressemblait à un poisson d'avril. Mais la saison des canulars printaniers n'étaient plus d'actualité. Lou Reed et Metallica collaboraient à un album commun. De quoi attiser la curiosité du badaud ? Du préposé, pas vraiment, tant le dernier The Raven de papy Reed avait refroidi l'enthousiasme suscité par l'excellent Ecstasy (2000). Et un intérêt d'autant plus relatif à l'écoute de la dernière livraison des four horsemen (comme on dit dans le milieu), Death Magnetic, qui tentait de revenir vainement au thrash de leurs jeunes années. Bref, à part être attiré par une curiosité malsaine et morbide, la sortie de Lulu n'allait aucunement bouleversé le quotidien des amateurs de musique. Or c'était oublier un peu vite le goût pour la viande faisandée qui anime le RHCS.
Promis en quelque sorte comme le chaînon manquant entre le lourdingue Berlin (1973) et le heavy Master of Puppets (1986), Lulu pouvait-il dans ce cas susciter un quelconque regain d'intérêt ? Sur le papier, le doute restait de mise, mais en bon charognard, la chronique d'une catastrophe annoncée devenait trop tentante, la date de sortie du délit méritait donc d'être notée quelque part... le 31 Octobre 2011. Inspiré par deux pièces de théâtre écrites par l'Allemand Frank Wedekind, l'album du quintette (accompagné d'un ensemble à cordes) se décompose [1] en deux disques d'une quarantaine de minutes pour dix chansons au total : faites le calcul, gare à l'indigestion...












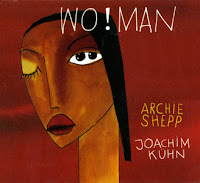
 Dans la mémoire du préposé, la musique de Blut Aus Nord pouvait se résumer à une introduction froide et lugubre, et à un riff, ou plutôt correction, LE riff : répétitif, imposant, majestueux (
Dans la mémoire du préposé, la musique de Blut Aus Nord pouvait se résumer à une introduction froide et lugubre, et à un riff, ou plutôt correction, LE riff : répétitif, imposant, majestueux (



































